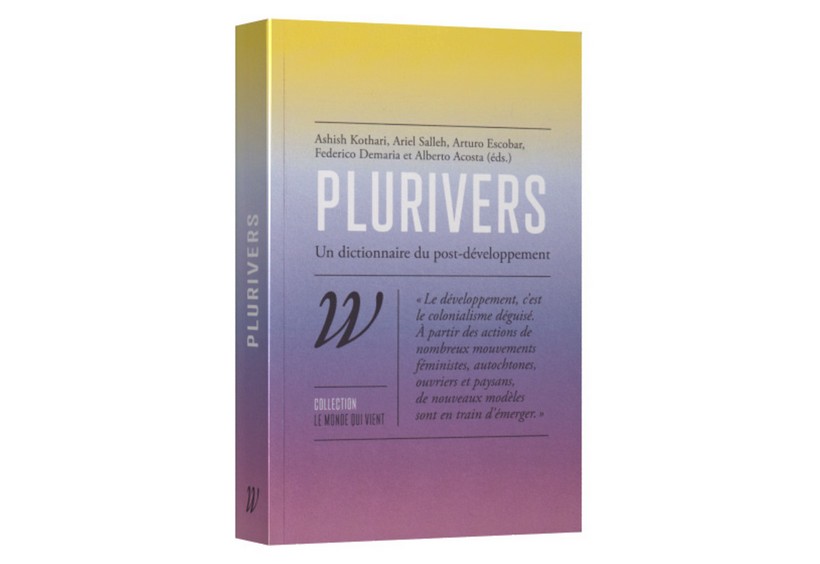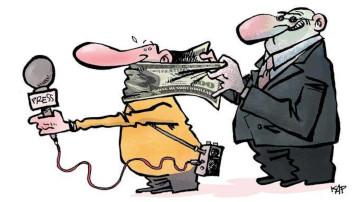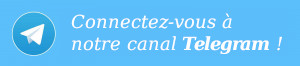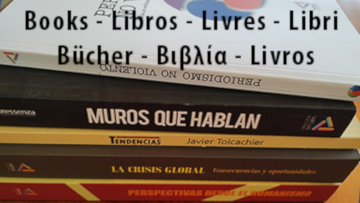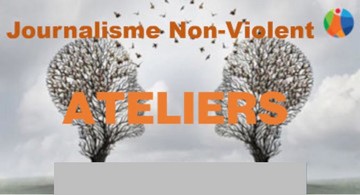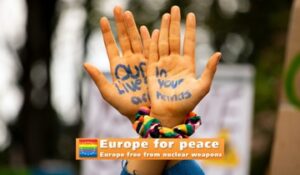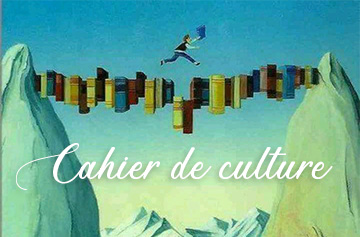Pour dépasser cette crise multifactorielle, de nouvelles voies sont nécessaires !
Si l’entreprise d’énergie allemande RWE est autorisé à excaver au village allemand Lützerath (N.d.E. : près de la mine de charbon à ciel ouvert Garzweiler), c’est que le gouvernement fédéral — et surtout les responsables des Verts — a décidé définitivement de tourner le dos à une politique climatique sérieuse, dont l’objectif de 1,5°C est par ailleurs insuffisant.
Le rapport du club de Rome publié en 2022 sous le titre Earth for All ne suscite aucun écho, au point que le scénario qui y est décrit, « Trop peu, trop tard » a toutes les chances de se réaliser. Avec encore plus d’inégalités, de tensions sociales, avec une augmentation des températures globales bien supérieure à 2°, avec des effets dévastateurs. L’autre scénario, qui pourrait sauver l’humanité avant son extinction, exigerait pour ainsi dire une révolution copernicienne immédiate : éradication de la pauvreté et des inégalités, habilitation des femmes, élaboration d’un système de nutrition sain et utilisation d’énergies propres. Rien de tout cela n’est en vue — et encore moins à l’échelle et dans l’urgence requises.
La catastrophe climatique n’est qu’une des nombreuses crises qui posent sérieusement la question de la survie de l’humanité. À la COP15, en décembre 2022, des représentant.es de près de 200 pays ont débattu du soutien à apporter à la biodiversité. Ces conférences se déroulent régulièrement, elles formulent des objectifs louables, certes, mais qui ne sont jamais atteints. L’exploitation et la pollution de la nature ne font qu’accélérer encore la marche vers l’extinction des espèces.
Le gouvernement fédéral décrit crûment les résultats de la COP15, qui seraient un « signe de fermeté ». « Il s’agit de placer sous protection d’ici à 2030 au minimum 30 % de la surface des terres et des mers, tandis que l’utilisation de pesticides devra avoir diminué de moitié. Enfin, il faudrait mettre plus d’argent pour la protection de la biodiversité. » Le Nabu (Naturschutzbund Deutschland e. V., Syndicat allemand de conservation de la nature et de la biodiversité) estime qu’on manque d’accords concrets pour la mise en œuvre d’objectifs mesurables. » Jörg-Andreas Krüger, le président du Nabu, insiste : « Avec cette crise climatique et de la nature, le monde se précipite dans l’abîme. Et pourtant, au lieu de freiner résolument, on remet les gaz. »
Dominée par l’Occident, la protection de la nature chasse les indigènes
En fonction des intérêts du moment, les résolutions aux accents les plus positifs peuvent aussi se retourner en leur contraire : par exemple, lorsque les fonds attribués se retrouvent dans des projets de greenwashing ou lorsqu’on déplace des indigènes au nom de la protection de la nature. Avant même cette rencontre, Amnesty International et d’autres ONG en avaient déjà appelé aux gouvernements : « Si on ne reprend pas cette affaire très sérieusement, l’objectif 30 × 30 (N.d.E. : initiative mondiale visant à protéger 30 % des terres, des eaux intérieures et des océans de la planète d’ici 2030.) va détruire la vie des populations indigènes et affecter considérablement les conditions de vie de la petite paysannerie traditionnelle tout en détournant l’attention des véritables raisons de l’effondrement de la biodiversité. » Les réserves naturelles de ce type représentent « la pierre angulaire des préoccupations dominantes à l’Ouest pour la protection de la nature » ; à ce jour, elles seraient à l’origine dans nombre de pays d’Afrique et d’Asie, de famines, de maladies et d’atteintes aux droits humains, qu’il s’agisse d’assassinats, de viols ou de tortures. » « Pour protéger les écosystèmes, il faudrait protéger les droits de ceux qui ‘y vivent et les connaissent’ ; c’est que 80 % de l’ensemble de la diversité biologique de la terre vient ‘de la terre ancestrale des peuples indigènes’ ». Leurs droits à la terre et à l’autodétermination doivent être préservés, comme le prévoient les Conventions internationales sur les droits humains.
Dans une présentation pour le Bundestag allemand, l’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques) avait fait référence en 2019 aux « contributions des peuples indigènes et des collectivités locales à l’amélioration et à l’entretien de la biodiversité et des campagnes, domestiques comme sauvages. » et réaffirmé que cela représentait aussi « une conception alternative de la relation entre l’humain et la nature.
Ce qui manque, pour l’instant, c’est l’attention nécessaire, un aspect qui devrait jouer un rôle majeur dans les luttes climatiques. L’idée est largement répandue que le capitalisme est soumis à des contraintes structurelles de croissance. Mais cela ne suffit pas à expliquer la violence vis-à-vis de l’humain et de la nature qui est inscrite culturellement dans la conception économique capitaliste. À partir d’une perspective féministe, une autre économie est nécessaire, mais pas suffisante pour une société post-croissance parce que la puissance patriarcale et coloniale, le pouvoir et la force sont antérieurs au capitalisme. (siehe dazu den Beitrag der Autorin unter #PoWaKap).
S’extraire des représentations habituelles
À propos des multiples crises et catastrophes, je considère qu’il est urgent de réviser de fond en comble notre réflexion et de la confronter avec d’autres modèles de l’humanité et du monde. Je pars du principe que de ce point de vue les visions du monde indigène pourraient nous être d’une grande aide. Non pas pour les adopter sans le moindre esprit critique, mais pour interroger nos propres modèles de pensée et de sensibilité, y compris nos propres préjugés contre des perspectives radicalement différentes des nôtres, à propos de l’homme, de la nature et de la vie. Au lieu de pseudo-solutions technologiques, au lieu de ce délire patriarcal de la faisabilité, on a besoin d’une transformation qui va dans le sens d’une vie bonne pour tous, à mon avis, et surtout de non-violence et de respect, d’humilité vis-à-vis des mystères de la vie ; on a besoin d’accepter que « nous » ne savons pas tout, que nous ne pouvons pas tout faire — ce qui ne veut absolument pas dire : rien faire !
Il est grand temps de se séparer de la représentation occidentale dominante du « développement ». Les limites dans la compréhension du monde des prétendues sciences de la nature — notamment la physique et la biologie — sont présentées de façon très convaincante à mon avis par le philosophe et artiste Fabian Scheidler dans son livre „Der Stoff, aus dem wir sind. Warum wir Natur und Gesellschaft neu denken müssen“ (La matière dont nous sommes faits. Pourquoi nous faut-il repenser la nature et la société ? L’auteur en fait une recension dans le numéro d’octobre 2021 de Graswurzelrevolution).
D’après Wolfgang Sachs, qui travaille depuis des décennies sur la question de la durabilité, le développement est un « mot plastique, une notion vide à signification positive. » : il le ressente comme un progrès qui devait permettre de combattre la pauvreté dans le monde entier — certes, il y a réussi, au moins partiellement, mais il a aussi induit « en contrepartie une inégalité encore plus grande et des dommages à l’environnement maintenant irréparables ». Dans son introduction au livre Pluriverse – A Post-Development Dictionary (Pluriverse, un dictionnaire du post-développement), il explique encore que l’introduction au Globale Nachhaltigkeitsziele (SDGs) (les Objectifs de développement durable), en 2015, a enterré « sans tambour ni trompette » le mythe du développement — une idée qui vit de la « dictature de la comparaison quantitative ». Depuis lors, il n’a plus jamais été question de rattrapage. En revanche, des objectifs universels ont été formulés pour le monde entier.
Un plurivers
Les idées de développement sont encore loin d’avoir totalement disparu ; la première question qui se pose aujourd’hui, c’est par quoi on pourrait les remplacer. Je me méfie fondamentalement de tous ceux qui pensent avoir trouvé une solution unique, une alternative à la société de croissance capitaliste. Je n’imagine pas la post-croissance et le post-développement, c’est-à-dire une organisation économique et sociale qui serait débarrassée du paradigme progrès et développement axé sur la croissance autrement que comme un réseau en mouvements de questionnements spiralés, comme quelque chose qui interroge, plutôt que comme un axe rectiligne, incontournable et quasi militaire.
Voilà pourquoi ce livre sur le plurivers m’a à ce point enthousiasmée. On y rencontre une bonne centaine d’auteur.ices qui présentent les concepts, les philosophies et les pratiques les plus diverses que l’on retrouve dans le monde entier, sur les plans économique, sociopolitique et culturel. Le post-développement présente des alternatives qui protègent et respectent la vie sur la Terre : un plurivers de plusieurs mondes possibles, qui inclut des critiques du système et des modes de vie diversifiés. Ce lexique vise à repolitiser les débats en cours sur la transformation socio-écologique en abordant son caractère multidimensionnel. Il est dédié à ceux qui militent pour le plurivers, qui luttent contre l’injustice et qui cherchent une voie pour une vie en harmonie avec la nature.
C’est lors de la quatrième conférence internationale sur la décroissance qui a eu lieu à Leipzig en septembre 2014 que l’économiste et ancien ministre équatorien de l’Énergie et des Mines Alberto Acosta, le professeur en économie écologique et politique Demaria Federico et le fondateur du groupe environnemental indien Kalpavriksh, Ashish Kothari, ont envisagé pour la première fois l’idée de ce livre. Par la suite, ils ont associé à leur projet la sociologue et activiste Ariel Salleh, chercheuse en écopsychologie et écoféminisme et le professeur émérite en anthropologie Arturo Escobar. En leur qualité d’éditeur.rices, ils conçoivent ce livre « comme une invite à chercher ce que nous regardons comme des ‘manières d’être’ relationnelles ». Ils voudraient enrichir l’analyse marxiste « de perspectives telles que le féminisme et l’écologie, mais aussi d’idées issues du Sud global, sans oublier les idéaux gandhiens. »
La première édition, anglaise, a paru en 2019 en Inde ; elle a déjà été traduite en français (Plurivers : Un dictionnaire du post-développement), en italien, en portugais et en espagnol, d’autres langues vont suivre. Cette année encore, c’est l’AG SPAK-Verlag qui rend accessible le livre aux lecteurs allemands, en version papier et en ligne. Les questions qu’il soulève, nous souhaitons les discuter de la façon le plus large possible, et bien sûr par le biais du blog Postcroissance (Blog Postwachstum).
Note sur la transparence : l’auteur participe à la publication du livre Pluriversum en allemand.
L’article d’Elisabeth Voß a été publié initialement dans le Blog Postwachstum.
Cet article est sous licence Creative Commons (Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modification 3.0 Allemagne). Il peut être distribué et reproduit dans le respect des conditions de la licence.
Tous les articles concernant la thématique de la série Pluriversum sont disponibles ici.
Traduit de l’allemand par Didier Aviat