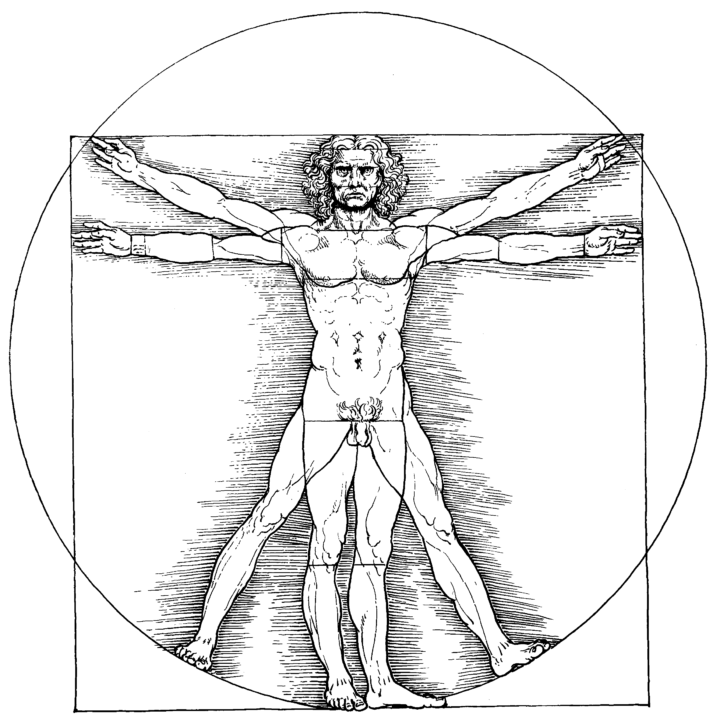Cet homme est professeur de politique environnementale et de développement durable à l’université Yale de New Haven (Connecticut), l’une des universités les plus réputées au monde. Il a été conseiller principal de la Commission nationale de l’environnement sous les présidents américains Jimmy Carter et Bill Clinton. Mais ce n’est que maintenant qu’il comprend ! Il s’appelle Gus Speth.
Dans une interview accordée au New York Times, Speth, qui pendant des années a occupé un poste important en mettant en garde contre la menace d’écocide, arrive à une conclusion peu encourageante.
« Je pensais, avant », dit-il dans une déclaration déprimante, « que les plus grands problèmes environnementaux étaient la perte de la biodiversité, l’effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais que 30 ans de « bonne science » pouvaient résoudre ces problèmes. Je me suis trompé. Les plus grands problèmes environnementaux sont l’égoïsme, l’avidité et l’indifférence, et pour y faire face, nous avons besoin d’un changement culturel et spirituel. Et nous, les scientifiques, ne savons pas comment faire ça ».
Si l’on ne croit pas que la dégringolade est irrémédiablement entamée, – car nous sommes déjà confrontés à des dommages irréparables à long terme de la terre (déchets nucléaires, déforestation des forêts tropicales, perte de biodiversité, utilisation de pesticides dans l’agriculture), de l’eau (inondation de plastique) et de l’air (géo-ingénierie)-, on doit au moins admettre que la transformation de notre culture de consommation mondiale sera l’événement le plus important de l’histoire de l’humanité. Et, comme le craint à juste titre Gus Speth, il n’y a rien pour l’affronter.
Et nous avons eu notre chance. Nous l’avons toujours eue. Nous ne pouvions tout simplement pas l’utiliser parce qu’en tant que communauté politique, nous n’avions aucune idée de ce que nous voulions être et de qui nous voulions réellement être, au-delà de notre existence de consommateur de plus en plus misérable dans le pluralisme fictif de quelques sociétés. Au cours des dernières décennies, les intérêts de profit d’une élite financière et économique criminelle ont étouffé toute solution raisonnable aux problèmes.
Comment est-il possible que toutes les actions destructrices que nous devons vivre soient célébrées par les responsables comme des actes créatifs ? Le bombardement d’autres pays, la construction de barrages, la pulvérisation d’insecticides, la création d’organismes génétiquement manipulés…, tout cela est considéré comme nécessaire, progressif et créatif !
Nous considérons la santé comme une prestation de l’industrie pharmaceutique, nous considérons la sécurité sociale comme quelque chose que la police et la justice produisent. Il en est de même dans presque tous les domaines : nous croyons exclusivement aux solutions par des règles politiques ou des améliorations techniques. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que notre société obéit au patriarcat, dont les valeurs centrales sont la supériorité et la domination. C’est pourquoi il est extrêmement important que nous remettions en jeu le principe féminin.
Dans les cultures des peuples indigènes, le pouvoir créatif de la nature est considéré comme féminin. La reconnaissance de cette force nous rend humble face à la vie et nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas son maître. Si chaque être humain était prêt, en lui-même, à laisser libre cours au principe féminin, nous ferions l’expérience que l’autosuffisance, la confiance en soi et l’autodétermination seraient en tête de l’agenda politique.
Mais maintenant, quelle salade ! Faire prendre conscience aux gens qu’ils ne sont pas seulement des êtres culturels mais aussi des êtres naturels qui ont intériorisé que la nature a le droit d’exister, indépendamment du fait qu’ils en tirent ou non une utilisation directe, est une tâche herculéenne que personne ne sait comment accomplir. En outre, la frustration envers un système qui ne sait se définir qu’à travers les principes capitalistes est aujourd’hui énorme.
Beaucoup de gens ne veulent plus accepter que chacune de leurs actions productives soit pressée dans un système économique mondial pour en tirer profit. Ils aspirent à une identité. Ils ne peuvent trouver leur identité qu’en s’attaquant à leurs problèmes au niveau local. La seule façon de maîtriser la catastrophe mondiale est de trouver des solutions locales à l’échelle mondiale. C’est ce qu’il faut avant tout propager.
Le professeur Klaus Bosselmann (67 ans) est considéré comme l’un des plus importants penseurs sur le système juridique écologique. Dans une interview avec Geseko von Lübke (Politik des Herzens, Arun Verlag), il a déclaré ce qui suit :
« Nos politiciens sont pratiquement aveuglés par l’idée de produire des chiffres de croissance et n’ont absolument aucune sensibilité sur ce qui fait vraiment bouger les gens. Ils ne comprennent pas qu’il s’agit d’une crise de sens qui est bien plus profonde que la déception causée par la situation économique difficile. La crise du sens est liée au fait que l’impuissance de la politique est ressentie de plus en plus fortement, mais nous ne savons pas comment réagir à ces changements, qui sont d’abord vécus comme négatifs. Je pense donc que nous sommes effectivement au début d’une ère où le contenu écologique peut être expérimenté en premier lieu. Ce n’est que par la suite, qu’ils déboucheront sur des formes économiques et sociales pour lesquelles nous n’avons pas encore de concepts. Il existe la possibilité que nous tirions les conclusions décisives de la crise écologique et que nous comprenions que nous avons créé nous-mêmes les problèmes environnementaux. Nous les avons créés dans notre esprit, dans l’image que nous avons de nous-mêmes, et c’est là que devrait se trouver la clé pour les résoudre.
Jusqu’à présent, nous n’avons compris la protection de l’environnement que comme la protection des êtres humains ; jusqu’à présent, nous avons parlé de stocks lorsqu’il s’agissait de la nature. Nous avons fait nos calculs en tout. Cette pensée n’était pas liée à la vie, mais à une mentalité de comptable.
La terre est un système vivant dans lequel toutes les choses sont imbriquées et dépendent les unes des autres. Est-ce si difficile à comprendre ? Nous vivons tous de la terre, c’est elle qui nous dispense la vie. Quelqu’un croit-il sérieusement que quelque chose qui donne la vie puisse être lui-même sans vie ? Ce n’est que lorsque nous serons prêts à nous comprendre comme faisant partie d’un corps vivant, celui de la terre, que notre position dans le monde changera fondamentalement.
Une telle perspective a des conséquences drastiques sur notre croissance intérieure et collective. Elle peut sembler visionnaire et rêveuse au vu des problèmes actuels, mais une société qui ne développe pas de visions n’est pas durable. Pour la première fois de notre histoire, nous sommes confrontés à la destruction auto-induite de toutes les bases biologiques de la vie. Aucune génération avant nous n’a eu à subir une telle menace.
Nous devons donc nous demander : que voulons-nous ? Qui sommes-nous ? De quoi avons-nous réellement besoin ? En nous interrogeant ainsi, nous ne nous contentons pas de former notre perception, nous reformulons aussi nos besoins.
Il y a maintenant beaucoup de gens dans le monde qui ont opéré ce changement de conscience, et ils sont plus nombreux chaque jour. Tout cela se passe à un rythme effréné, et cela se passe maintenant. Les représentants de l’ancien système le savent. Ils savent que leurs directives, normes et valeurs ne fonctionnent plus.
Un tel effondrement des valeurs est d’abord effrayant. Nous avons peur du chaos et de l’anarchie, peur de sombrer dans ce scénario de fin des temps où tout un chacun essaie de s’opposer aux autres. Mais ce n’est pas nous qui sommes condamnés à mourir, ce sont nos anciennes façons de voir et d’agir qui meurent. Aujourd’hui, nous devons essentiellement faire face à deux tâches en même temps : en tant qu’accompagnants à mourir d’un système délabré et en tant que sages-femmes d’une nouvelle culture.
Si nous parvenons à laisser fleurir en nous une vision positive de l’avenir, nous pourrons alors la mettre en œuvre dans la politique pratique. Car rien de nouveau ne viendra au monde à travers nous qui n’ait auparavant pris forme dans notre conscience.
Le 19 juillet 1851, l’écrivain américain Henry David Thoreau (1817 – 1862) écrivait dans son journal les phrases suivantes :
« J’ai trente-quatre ans et pourtant ma vie est presque entièrement dévoilée. Qu’y a-t-il encore à germer ? Il y a souvent un tel décalage temporel entre mon idéal et la réalité que je peux dire que je ne suis pas encore né ».
Cela ne s’applique-t-il pas à l’humanité dans son ensemble ? Ne sommes-nous pas justement nous aussi ‘non encore révélés’ ? Et en tant que famille humaine, ne portons-nous pas aussi en nous le germe de la compréhension qui, une fois épanoui, nous intègre à nouveau dans la création, que nous n’avons jusqu’à présent que tenté de contrôler ? Mais on ne peut vouloir contrôler que quelque chose dont on est fondamentalement séparé. Ce malentendu doit cesser. Ou bien il en sera fini de nous.
Note de la rédaction : L’essai de Dirk C. Fleck a été publié sous le titre « Nous avons besoin d’un changement culturel et spirituel. Mais comment cela peut-il marcher ? » sur Kenfm.de et a été repris par Neue Debatte. Des liens ont été ajoutés et des paragraphes individuels ont été insérés et mis en évidence pour une meilleure lisibilité sur le net.
Traduction de l’allemand, Claudie Baudoin