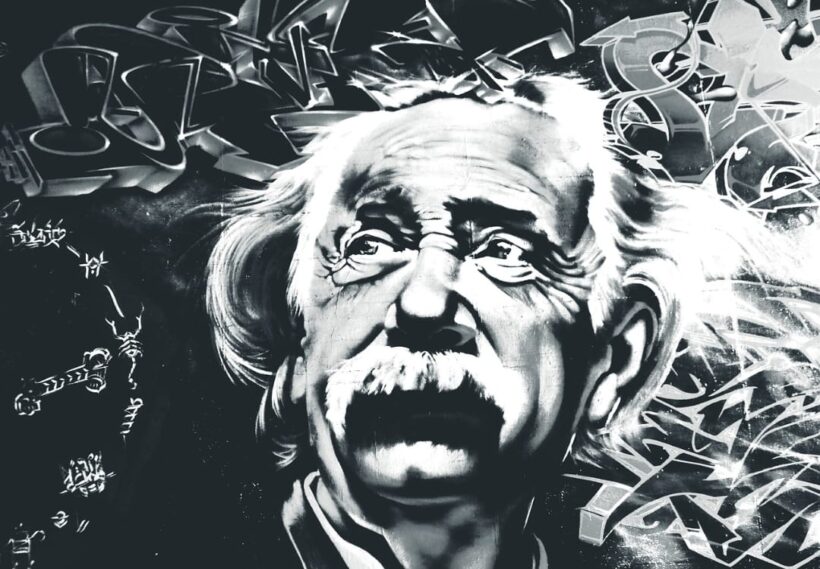La physique contemporaine a appris à décrire l’univers avec une précision inédite. Pourtant, lorsqu’elle tente de dire ce qu’est le temps, elle trébuche sans cesse. Peut-être que le problème ne réside pas seulement dans les modèles, mais dans le langage avec lequel nous les pensons et dans l’ordre implicite par lequel nous les articulons.
Pendant des décennies, l’histoire de l’univers — et avec elle, celle du temps — a été racontée comme une séquence ordonnée et relativement propre. D’abord un cosmos primitif, simple, presque transparent. Puis un univers de plus en plus structuré, chimiquement enrichi et « mûr ». C’est un récit efficace, pédagogique, utile pour l’enseignement. Mais cette efficacité a un coût : elle aplatit le processus.
La physique contemporaine repose sur trois grands cadres théoriques pour décrire l’univers. La relativité générale explique la structure de l’espace-temps et la gravitation à grande échelle. La mécanique quantique décrit le comportement de la matière et de l’énergie à l’échelle microscopique. La thermodynamique, quant à elle, introduit l’irréversibilité, les flux d’énergie et la croissance de l’entropie.
Dans l’enseignement classique, ces cadres sont souvent présentés comme des domaines séparés qui se superposent sans ordre conceptuel explicite. Parfois, la relativité apparaît comme le « cadre général » de l’univers ; parfois, la mécanique quantique est traitée comme le fondement ultime ; la thermodynamique est fréquemment reléguée à une théorie secondaire, presque technique, associée à la chaleur, aux moteurs ou aux statistiques.
Cet ordre implicite est rarement formulé, mais il opère néanmoins. Et il a des conséquences sur notre manière de penser le temps.
Dans ce récit, la relativité fournit un espace-temps géométrique dans lequel tout se produit ; la mécanique quantique introduit des étrangetés locales, des probabilités et des discontinuités ; la thermodynamique apparaît comme une conséquence macroscopique, une sorte d’effet secondaire du comportement collectif. Le temps, dans ce schéma, se retrouve pris entre une géométrie presque éternelle et une probabilité qui ne tranche pas.
Pourtant, cette manière d’ordonner les théories ne rend pas pleinement compte de ce que la physique elle-même a progressivement mis en évidence.
Observée de près, la mécanique quantique ne décrit pas des états décidés, mais des possibilités ouvertes. Superpositions, amplitudes de probabilité, futurs coexistants. Conceptuellement, la théorie quantique ne dit pas « ceci est », mais « ceci pourrait être ». C’est le domaine du « pourrait ». Rien n’est encore fixé.
La thermodynamique introduit quelque chose de qualitativement différent. Toute interaction qui laisse une trace implique une décision irréversible. La production d’entropie n’est pas seulement une grandeur physique : c’est une forme de mémoire. Là où la mécanique quantique maintient ouvertes plusieurs trajectoires, la thermodynamique en sélectionne une et élimine les autres. Elle transforme la possibilité en histoire.
La relativité, pour sa part, n’ouvre pas de possibilités et ne décide pas. Elle soutient. Elle décrit la géométrie dynamique de l’espace-temps dans laquelle ce qui a déjà été décidé persiste, se relie et conditionne ce qui vient ensuite. C’est le cadre de l’être-en-train-d’être : non pas l’essence de l’univers, mais son équilibre dynamique.
Dans cette lecture, l’ordre change. Non par hiérarchie ontologique, mais par fonction au sein du processus.
D’abord, l’ouverture : la mécanique quantique comme champ des possibles.
Ensuite, la décision : la thermodynamique comme opérateur de l’irréversibilité.
Enfin, le soutien : la relativité comme géométrie dynamique de l’être-en-train-d’être.
Cet ordonnancement ne cherche pas à remplacer les modèles existants ni à résoudre l’unification de la physique. Il propose autre chose : une relecture conceptuelle du processus.
C’est ici que le langage devient décisif.
L’anglais, langue dominante de la science contemporaine, ne distingue pas entre l’être comme identité et l’être comme état. Tout se confond dans le « to be ». Cette absence n’empêche pas la physique, mais elle pousse la pensée vers des formulations qui privilégient l’identité, même lorsque l’objet d’étude est le devenir.
Le français, comme l’anglais, ne dispose pas non plus d’une distinction grammaticale stricte équivalente à celle du couple espagnol ser / estar. Toutefois, il permet, par des constructions périphrastiques, d’approcher l’idée d’un être en cours, d’un état dynamique. L’espagnol, en revanche, rend cette distinction explicite, notamment à travers la forme estar siendo, qui ne fixe pas, ne clôt pas, n’essentialise pas, mais nomme un processus en train de se faire.
Cette distinction ne crée pas une nouvelle physique. Mais elle permet de penser plus clairement ce que la physique montre déjà : que rien dans l’univers n’« est » de manière statique. Tout est en train d’être. La matière, l’espace, le temps, et même nous-mêmes, sommes des équilibres dynamiques : suffisamment stables pour persister, suffisamment instables pour changer.
Dans cette perspective, le temps cesse d’être une chose. Il n’est ni une substance ni une flèche abstraite. Le temps émerge du processus lui-même : de l’ouverture des possibles, des décisions irréversibles et du soutien qui les maintient en relation.
Une idée clé apparaît alors, souvent perdue lorsque l’on ne regarde que les modèles : les modèles fonctionnent en moyenne. De loin. Comme la Lune, qui vue depuis la Terre semble lisse et parfaite. Ce n’est qu’en s’en approchant que surgissent les cratères, les fractures, les aspérités.
L’univers n’est pas homogène à toutes les échelles. Il ne l’a jamais été. L’expansion n’a pas été parfaitement uniforme, la formation des structures n’a pas été simultanée, la « maturité » du cosmos ne s’est pas produite de manière homogène. Il existe des retards, des irrégularités, des persistances inattendues. Des aspérités.
Cela n’invalide pas les modèles. Cela les replace à leur juste place : des outils pour penser des processus, non des récits clos.
Peut-être que le problème n’est pas que la physique ne comprend pas le temps. Peut-être que le problème est que nous continuons à tenter d’en parler comme s’il s’agissait de quelque chose qui est, alors que ce qu’il fait réellement, c’est d’être en train d’être.
Et pour penser cela, parfois, il faut changer l’ordre.
Et parfois, il faut aussi changer de langue.
Note
Cet article repose sur une réflexion développée initialement par l’autrice dans le cadre de la philosophie de la physique et de la sémiotique de la science, et dialogue avec des apports de la mécanique quantique, de la thermodynamique et de la relativité contemporaine.